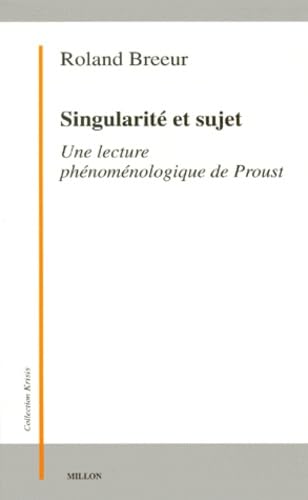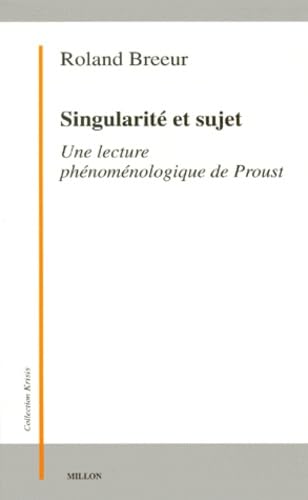Comment le peintre ou le poète, demande Merleau-Ponty, seraient-ils
autre chose que leur rencontre avec le monde ? Certes, ils ne sont rien de plus.
Mais ne sont-ils pas moins que cela ? Le poète ne serait-il pas plutôt
l’expression de l’épreuve d’avoir d’entrée raté ce monde, comme Marcel
dira d’avoir d’entrée raté Gilberte ou Albertine ?
Il y a en effet quelque chose qui trouble la complicité qui lie le
sujet au monde. Au sein de la réversibilité qui conditionne notre
rapport au monde ou à l’Être, quelque chose insiste qui ne contribue pas
à l’approfondissement de ce rapport. Ce quelque chose s’excepte du
mouvement selon lequel le sujet répond aux sollicitations venant du
monde : il s’agit d’un noyau sourd et muet, sourd parce qu’il n’entend
rien, muet parce qu’il ne donne rien à entendre. Il ne s’inscrit pas
dans l’ordre d’être que je découvre et par là me rend étranger au monde
qui me regarde. Ce noyau, c’est la singularité.
Comment cette singularité, qui semble fortement déterminer les
descriptions proustiennes du sujet, s’affirme-t-elle ? Il semble qu’il y
ait bel et bien un « solipsisme » chez Proust, au sens où le contact
avec le monde est lui-même alourdi d’un rapport à quelque chose en moi
qui ne se répand pas dans ce contact, m’isolant dès lors du monde et
d’autrui. Décrire ce « solipsisme » selon lequel tout rapport au monde
et à l’Être semblent d’emblée singularisés, voilà l’enjeu de cet
ouvrage.