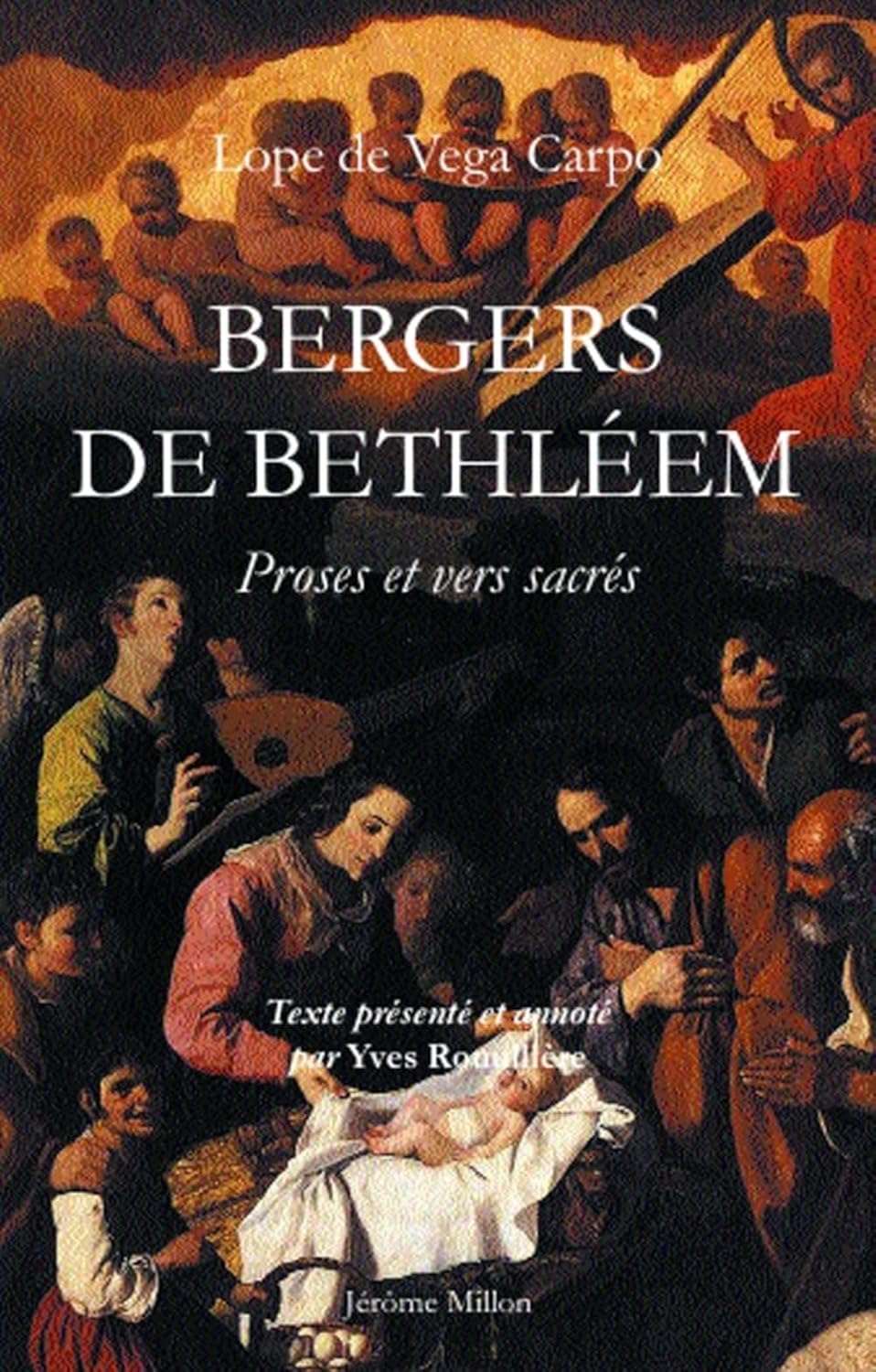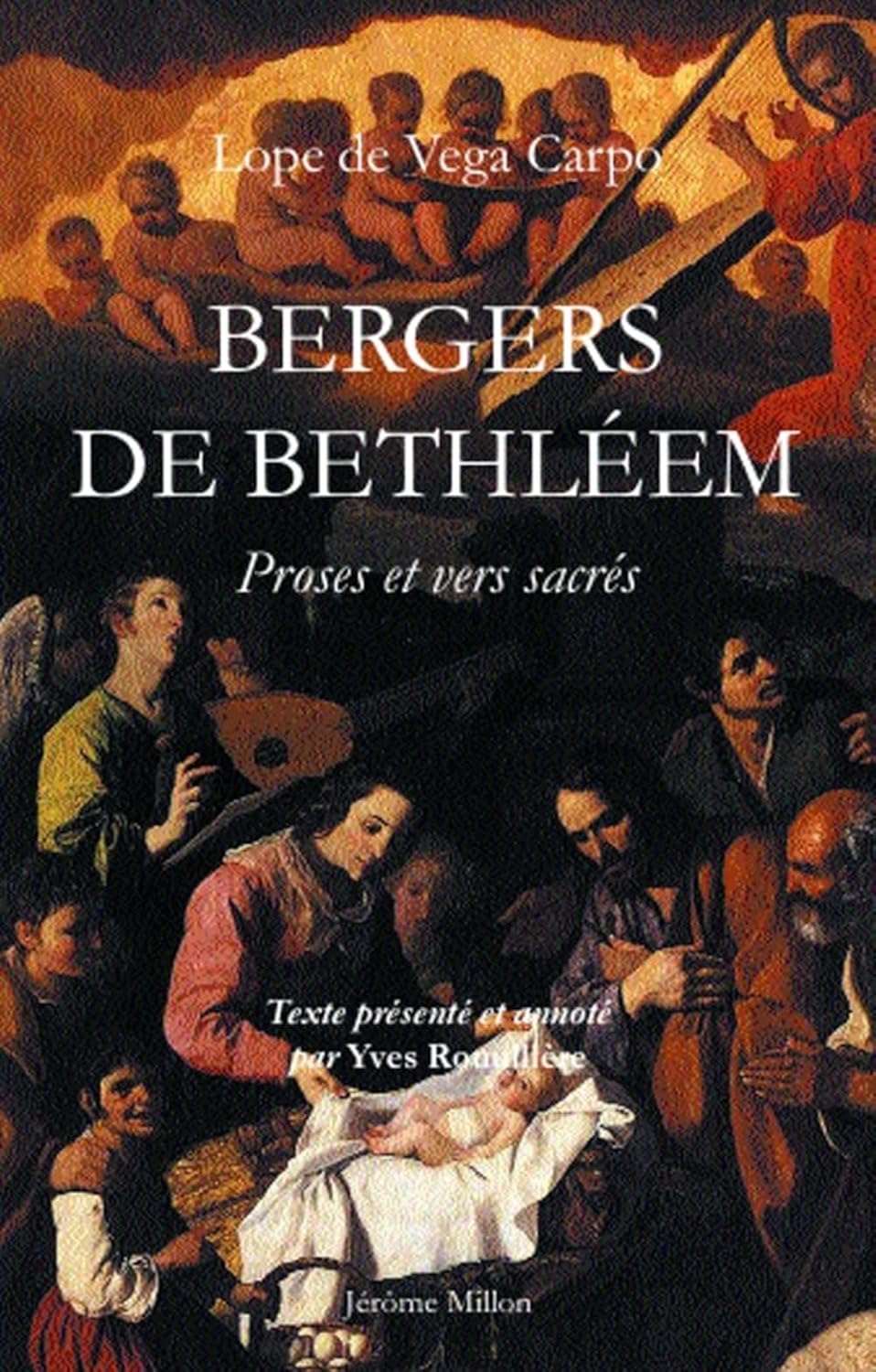Bergers de Bethléem (1612) est un des chefs-d’œuvre (inédit en
français) de Lope de Vega et l’un de ses plus grands succès (on n’en
compte plus les rééditions ou réadaptations). Écrit en pleine maturité,
au sommet de sa gloire, il s’agit d’une de ses œuvres totales, de celles
qui résument tout son art. Lope, à l’âge de cinquante ans, avant d’être
accepté dans le tiers-ordre franciscain, vient d’entrer dans la
congrégation des « esclaves du Très-Saint Sacrement ». Il s’agira, selon
ses propres dires, de ses « meilleures années », durant lesquelles il
composera de nombreuses pièces religieuses (dont ses fameux Soliloques amoureux d’une âme à Dieu).
Trois genres littéraires s’imbriquent dans Bergers de Bethléem.
D’abord, le genre didactique (paraphrase des Étymologies d’Isidore de
Séville) qui constitue en soi un bon document sur la pratique de
l’exégèse teintée d’astrologie et d’ésotérisme que les auteurs
renaissants utilisaient sans complexe à la Renaissance, y compris dans
leurs ouvrages apologétiques. On retrouve aussi et surtout dans cette
œuvre le génie poétique de Lope : la plupart des spécialistes
s’accordent pour dire que les sonnets, gloses, romances, villanelles,
paraphrases psalmiques, etc., de Bergers de Bethléem sont parmi
les plus inspirées de son œuvre. On sait son excellence à décrire le
sentiment amoureux et à camper comme de l’intérieur des personnages de
femmes (cf. La Dorotea). On connaît moins sa manière d’exprimer
le sentiment enfantin sous ses multiples aspects qui touchent ici au
sublime. En dernier lieu, on retrouve évidemment le génie théâtral de
Lope à travers ses nombreux dialogues (louanges, défis, jeux de mots,
etc.) des bergers entre eux et avec chaque personnage rencontré en cours
de route. Ces dialogues, à la fois naïfs et savants, selon la loi du
genre, ont le liant indispensable pour rendre crédible le passage du
didactique au poétique.