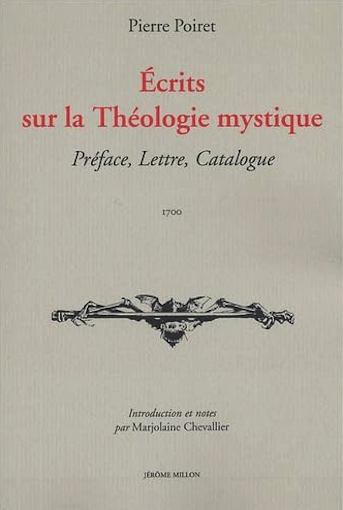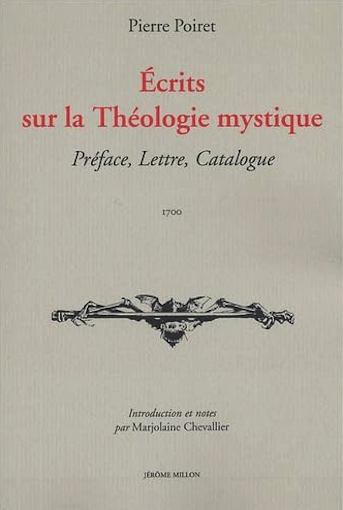Pourquoi les remettre en lumière ? La question se pose d’autant plus
qu’ils ne constituent pas une œuvre en soi, mais se sont présentés à
l’origine comme une préface et des annexes, écrites par Pierre Poiret
dans une anthologie dont une bonne partie n’était pas de lui.
Plus personne ne sait qui est Poiret. Le public auquel il s’adressait
en premier lieu était celui des Huguenots français réfugiés aux
Pays-Bas, un milieu qui, traditionnellement, n’était pas très ouvert à
la Théologie mystique dont cet ex-pasteur protestant s’était fait le
champion. La mystique elle-même venait certes, durant quelque temps, de «
faire la une de l’actualité » (dirions-nous !) avec le conflit ouvert
entre deux éminents prélats : l’évêque Bossuet, et l’archevêque Fénelon,
précisément sur la validité de l’expression mystique de la foi…
L’intérêt est donc multiple et au moins triple.
Attirer l’attention, une nouvelle fois, sur l’auteur Pierre Poiret et
sur une facette mal connue de sa démarche originale. Revenir à
l’importance historique du contexte : le climat extrêmement tendu de ce
tournant de siècle, les diverses réactions protestantes à la récente
condamnation de Fénelon etc.
Reconnaître, enfin, la qualité du contenu lui-même. Dans notre temps
où beaucoup de gens sont en quête dans le domaine de la spiritualité,
tout en ne se préoccupant plus guère des appartenances confessionnelles,
la réflexion de Poiret sur la Théologie mystique retrouve une
certaine actualité. Ses analyses, son effort pour regrouper divers
auteurs spirituels en quelques familles, et jusqu’à sa lutte polémique
contre les simplifications, les malentendus, les moqueries que suscite
toujours la mystique… tout cela retrouve aujourd’hui un intérêt d’un
autre ordre que la valeur historique d’une pièce de musée.