Collections : Hors Collection
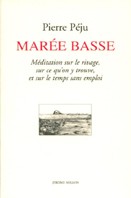
PÉJU Pierre
Marée basse
Méditation sur le rivage, sur ce qu’on y trouve, et sur le temps sans emploi
ISBN : 2-84137-254-6
EAN13 : 9782841372546
Année : 2009
96 pages
11.15 €
Bribes de mémoire. Fragments de passé. Images de voyages déchirées en
petits morceaux. Mais aussi regrets amers, boules de vieille angoisse
hérissées de piquants, chevelures trempées de tristesse. Voilà ce qu’on
glane, en soi, autour de soi, quand l’écriture est à marée basse.
Alors, on finit par désirer le retour des grandes marées. Rêver de
la mer qui non seulement submerge tout, mais se précipite avec violence
sur ces choses à moitié mortes qui, hors de l’eau, seraient vouées à la
pourriture nostalgique.
Pierre Péju est l’auteur de plusieurs romans, notamment Naissances, La petite Chartreuse (prix du livre Inter 2003, porté à l’écran en 2005), Le Rire de l’ogre (prix du roman Fnac en 2005), Cœur de pierre, La diagonale du vide, tous parus aux éditions Gallimard, et d’essais dont La petite fille dans la forêt des contes paru aux Éditions Robert Laffont ou Lignes de vies aux Éditions José Corti.
____________________
EXTRAITS
Marée basse. Le vieil océan retiré très loin. Disparu. Ses draps gris
et trempés enroulés autour de la ligne d’horizon. Désert général. Grève
illimitée.
Cerné par tant de vide et devenu léger, au point de ne laisser que
des traces peu profondes dans le sable humide, le promeneur solitaire
est confronté à «ce qui reste» : choses échouées, devenues rondes et
douces à force d’avoir été épluchées par les lames; coquilles qui se
brisent sous la semelle et coquillages qui se meurent; cailloux lavés
des millions de fois, flaques reflétant un ciel lointain entre les
roches noires, bois flottés, morceau de liège, algues rousses, plumes de
mouettes, carapaces de crabes vidées et écrasées, trous comme des anus
crachant une bave salée, étoiles de mer aux teintes délavées, méduses
gluantes, hippocampes morts et aussi plats que des marque-pages. À marée
basse, toutes ces choses pourtant éparpillées par le hasard, paraissent
méticuleusement disposées sur les lignes ondulantes que les eaux ont
laissées derrière elles en se retirant, telles les notes d’une
ritournelle élémentaire sur une partition un peu ivre…
Ces premiers mots sur la page blanche, je les trace, en ce mois de
juin 2009, confronté à ce qui m’apparaît comme une «marée basse de
l’écriture».
Une impression de vide, d’attente et de léger vertige. Au cours de
ma vie, j’ai connu plusieurs fois de tels moments. Ils font
généralement suite à l’achèvement d’un livre, parti chez l’imprimeur,
achevé d’imprimer, mais pas encore distribué chez les libraires, et
n’ayant donc fait l’objet d’aucune lecture, mises à part celles de
quelques professionnels, de proches ou d’amis. Cette fois, il s’agit
d’un roman auquel j’ai travaillé durant de longs mois, deux ans, trois
ans et plus encore si j’admets que je le portais bien avant de me mettre
à l’écrire (en réponse à quel appel énigmatique?). Roman, intitulé la
Diagonale du vide, auquel j’ai mis un point final après l’avoir relu des
centaines de fois, modifié jusqu’à la dernière seconde, changeant un
adjectif, supprimant une phrase, déplaçant un paragraphe.
À la minute même où l’ouvrage est mis en fabrication, sur décision
de l’éditeur, après une ultime possibilité de changer ici ou là un
détail ou une erreur lors de la correction des «épreuves», il n’y a plus
rien à faire! Je ne reverrai mon texte que pétrifié dans ses habits
neufs —titre (retenu après tant d’hésitations), quatrième page de
couverture, belle typographie—, un peu comme on revoit un mort après le
passage des embaumeurs. Sa résurrection et sa seconde vie me
concerneront, bien sûr, mais d’une autre façon.
Ce long récit auquel je pensais chaque jour, que j’écrive ou que
je n’écrive pas, il me faut admettre que désormais «je ne peux plus rien
pour lui» ! Et cela me laisse désemparé ou comme anesthésié. Sur quel
rivage?
Depuis le début de l’été, la mer des phrases s’est retirée très
loin. Et pas seulement les phrases de ce roman qui «paraîtra», rigide et
blanc, dans quelques semaines, mais la masse bouillonnante des
brouillons, des esquisses, des carnets où je notais tant de détails
préparatoires, des cahiers où j’ai tant de fois «commencé» puis
recommencé tel ou tel chapitre, d’une petite écriture au stylo à encre
noire, bien vite surchargée de ratures, sans parler de toutes ces
«sorties sur papier» crachées par l’imprimante, relues puis grattées,
biffées, griffonnées et retapées à l’ordinateur. Pendant des mois, j’ai
navigué en haute mer romanesque. Toute une histoire! La houle et la
foule. Des personnages qui m’accompagnaient et dont j’imaginais
l’existence bien au-delà de ce que nécessitait leur évocation.
Apparence, date de naissance, façons de parler, visages, le corps et les
mains. Un récit comme une longue traversée. Tantôt en proie à la
nausée, tantôt emporté par la joie narrative, j’ai navigué.

Rivages sauvages. Rivages du Nord-Ouest. Atlantique, Manche,
mer du Nord, mer d’Irlande. Mais aussi Baltique… Ces lieux chargés
d’impressions très vives, d’odeurs de varechs et d’embruns, avec le
sifflement du vent, les cris des oiseaux de mer, et le sempiternel
déchirement chuintant ou fracassant du ressac, sont aussi pour moi
emblématiques de quelque chose de plus intime et plus profond. Quoi?
Arrêt de l’agitation? Fin d’une œuvre? Bout du monde?
Je raconterai plus loin comment mes «essais» d’écriture les plus
précoces, entre douze et quatorze ans environ, furent induits par un
besoin assez vif de restituer l’atmosphère des rêves compliqués que je
faisais lorsque je n’étais pas en proie à d’importantes insomnies. Je
dispose, aujourd’hui encore, de très anciens «carnets de rêves» dans
lesquels la difficulté que j’avais à rendre, dans une langue simple, les
bizarreries, paradoxes baroques et absurdités de mes souvenirs
oniriques, tant que ceux-ci étaient frais, donnait lieu à des
contorsions verbales touchantes, du genre:
J’étais dans notre appartement qui n’était pas notre
appartement mais un vaste pré en pente, pourvu d’un mécanisme
d’horlogerie qui indiquait aussi l’heure, l’année, la saison, et qui,
doucement s’inclinait comme une benne basculant vers le vide, tandis que
je me cramponnais à des brins d’herbe qui étaient aussi des lettres de
l’alphabet découpées dans du métal, afin de ne pas tomber dans la saison
suivante, dans l’hiver, je ne sais pas…
Bref, mon goût du récit et ce qu’aujourd’hui encore je nomme
«la joie narrative» sont nés du désir de raconter des choses insolites
arrachées à la nuit. Avec, de temps en temps, le sentiment d’avoir
«retenu» un fragment. Mais en ce qui concerne ces atmosphères de «bord
d’océan», un des tout premiers rêves que j’ai noté, de l’écriture un peu
tarabiscotée que j’avais aux environs de ma treizième année, à l’encre
violette dans un carnet à petits carreaux, au dos toilé et à la
couverture chinée de rouge et de noir, est un «rêve d’océan».

Parmi la multitude des objets abîmés que je me souviens avoir ramassés à marée basse, quitte à ne les examiner que quelques secondes ou à les conserver au contraire de longues années, figure un «journal intime», trouvé au cours de vacances de Pâques, sur le sable, entre deux rochers, sur une plage de l’Atlantique, aux environs de ma douzième année. Véritable diary book à l’épaisse couverture reliée en cuir vert olive et pourvu d’un fermoir à petite serrure, il avait dû être bien malmené par les flots ou séjourner longtemps dans la mer, car la serrure à demi arrachée était rouillée, le cuir couvert de cloques et de taches de sel, et les pages agglutinées les unes aux autres par paquets de dix ou vingt. Déployé et blanc entre les chevelures vertes des algues, je l’avais d’abord pris pour un oiseau mort.
L’année inscrite en première page (1956 ou 58, je crois), et la date de chaque jour étaient encore déchiffrables, l’eau salée n’ayant pas eu complètement raison de l’encre d’imprimerie, mais la quasi totalité des textes manuscrits était illisible tant l’encre bleue de la petite écriture dont je ne devais jamais savoir si elle appartenait à un homme ou à une femme, avait été diluée. Ne subsistait plus, de cette vie racontée au jour le jour, que de longues bavures et nuées bleutées s’étirant en taches aquarellées vers le bord des pages croûteuses.
Quelques lettres, quelques mots anglais, quelques fragments de phrases étaient encore identifiables, mais ils ne permettaient pas de découvrir ne serait-ce qu’un peu de la substance de telle ou telle journée.
Ce manuscrit intime avait dû tomber à l’eau, ou être jeté à la mer, au mois de novembre, puisque les feuillets réservés aux jours des six dernières semaines de l’année, restaient vierges. M’en étant emparé, j’avais tenu le petit livre à bout de bras, espérant que le vent sécherait et décollerait les pages. Tout de suite l’objet m’avait semblé précieux, secret. J’étais ému et même gêné qu’il me fut échu. Quel était ce signe? Qui, quelque part au monde, s’était penché chaque soir sur ces pages? Et dans quelle solitude? Alors, à maintes reprises, et sans espoir de comprendre, je me laissais emporter par cette écriture brumeuse, ces nappes difformes, volutes, filaments et délavages spectraux, d’où le sens fuyait mais d’où le rêve jaillissait.
Longtemps, je me suis imaginé que ce diary book avait appartenu au passager d’un bateau croisant au large. Je pensai d’abord à un marin américain, semblable à ceux dont j’avais admiré le bob et l’uniforme blancs dans le port de Brest où mouillait leur navire de guerre. Un garçon très seul, très las des opérations de l’U.S. Navy, loin de chez lui, qui racontait ses journées ou consignait des pensées dont il ne pouvait faire part aux autres matelots. N’était-ce pas ses camarades, qui par brimade, un jour qu’il était absorbé par l’écriture, lui avaient arraché son «journal» aussitôt jeté à la mer. J’entendais leurs rires dans le bruit des moteurs du porte-avions ou du croiseur à la poupe duquel flottait la bannière étoilée. Je songeais au stylo inutile au bout des doigts du marin accablé par la perte irréparable. J’avais bien sûr songé aussi à une jeune fille, naviguant contre son gré sur un yacht luxueux, en compagnie d’individus qu’elle détestait (ses parents? Un homme auquel on l’avait unie contre son gré?). Cette fille rêvait, attendait, écrivait. C’est elle-même, un soir, en larmes, accoudée à la lisse, ses mains laissant pendre le journal au-dessus de l’écume, qui avait desserré ses doigts, et vu ses pages voleter un moment dans l’air vif avant de s’éloigner rapidement sur les vagues. Bref, un pauvre journal illisible, recueilli sur la plage m’avait donné l’occasion de flotter à mon tour de longues heures entre l’intime et l’anonyme, entre l’eau et les rêves.
À bonne distance, je croise d’autres promeneurs un peu flous qui pourraient aussi bien être des vivants que des morts. Ai-je un œil pour ces derniers? Je vois un homme vêtu d’un pantalon blanc dont il a retroussé les jambes et qui plaque une main sur son chapeau de paille que le vent menace d’emporter. Il semble sorti d’un roman dont il serait un personnage plutôt secondaire fuyant quelque compagnie mondaine afin de «s’ouvrir à nouveau à lui-même». À moins qu’il ne soit le narrateur de ce roman, en train de ruminer quelque formule du genre: dans les heures où ouverts aux autres par la conversation, nous sommes dans une certaine mesure fermés à nous-mêmes. (Proust)
Puis je remarque une femme seule dont les longues mèches brunes fouettent le front et les yeux. Elle entoure sa poitrine de ses bras croisés, comme si elle avait froid ou peut-être, elle aussi, pour ne pas se dissoudre dans une rêverie aussi vague que l’espace où elle est venue s’isoler. Enfin, passent des enfants, quatre, cinq, progressant les uns derrière les autres et bizarrement rangés par ordre de taille, armés de bâtons, de morceaux de bois flotté ou peut-être d’épuisettes. Ils pourraient être sortis d’un conte où quelque cachalot les aurait recrachés sur ce rivage après un long voyage dans ses entrailles. Je ne tiens pas à m’approcher de ces personnages, de crainte de découvrir des êtres miniatures, comme ces «Lilliputiens de cirque» qu’on m’avait emmené voir lorsque j’étais enfant, un homme et une femme adultes, aux corps bien conformés mais aux proportions extraordinairement réduites, ce qui m’avait causé une frayeur assez inexplicable puisqu’ils étaient bien plus petits que moi, à moins qu’intuitivement, tandis que le public s’esclaffait de les voir danser en smoking et robe du soir, j’aie su que nous avions affaire à des morts.
Tout au début de mon carnet, dont les pages tournent et claquent au vent, je tombe sur le relevé de ces mots de Virginia Woolf, pratiquement les derniers qu’elle ait inscrits dans son journal (le 24 mars 1941):Curieuse impression de bord de mer. Chacun s’arc-boutant, luttant contre le vent, saisi, réduit au silence. Entièrement vidé de sa chair.
Pour elle aussi, il y avait des spectres sur la grève. Quatre jours plus tard, elle se suicidait par noyade, en pénétrant lentement dans l’eau froide, les poches bourrées de pierres, se réduisant elle-même au silence, faute de s’être vidée de sa chair.
(……)