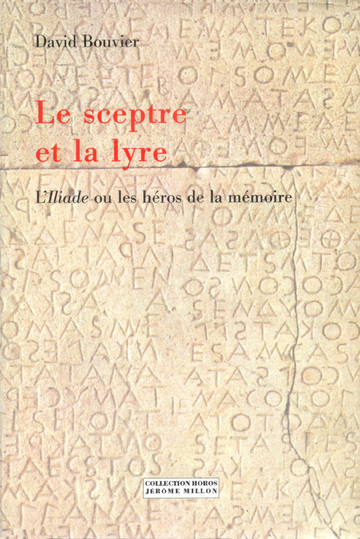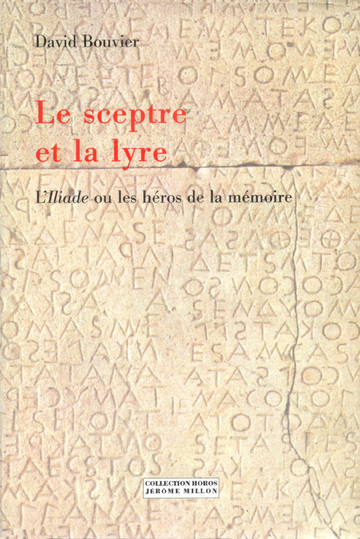Pour entrer dans cette problématique, une question initiale a été
choisie. Pourquoi l’aède de l’Iliade omet-il, au début de son poème, de
saluer l’auditoire auquel il s’adresse ? Comment procède-t-il alors pour
l’impliquer à un autre niveau ? La réponse arrive plus loin lorsque,
face à la mort, un héros comme Hector veut avant tout dédier son dernier
exploit aux hommes à venir. Entre l’aspiration d’un héros soucieux
d’être reconnu par les générations futures et l’auditeur de l’aède – qui
cherche une raison d’écouter l’histoire des héros – un lien s’établit
alors qui pose le problème de la dimension éthique de la poésie
héroïque.
Mais pour progresser, l’enquête se doit de préciser d’abord ce
qu’il en est, dans le monde héroïque, du code de l’honneur et de la
gloire. Dans le monde héroïque, il apparaît que la gloire est moins
individuelle que collective. La gloire d’un héros est un honneur pour
tout son clan mais, en même temps, elle constitue pour ce clan une forme
d’obligation : les descendants du héros ne pourront se réclamer de la
gloire des ancêtres que s’ils se révèlent, à leur tour, par leurs
propres exploits, dignes successeurs de ces ancêtres. Perpétuant
l’histoire exemplaire des héros, la poésie des aèdes se trouve, ainsi,
investie d’une dimension éthique : elle est ce discours qui invite les
générations nouvelles à se souvenir et à imiter les grands héros pour
hériter et prolonger leur gloire ; il y va ici d’une identité que la
collectivité ne doit pas perdre. Mais pour fonctionner, un tel système
éthique ne doit-il pas supposer une langue immuable, à même de conserver
fidèlement l’histoire des exploits dignes de mémoire ?