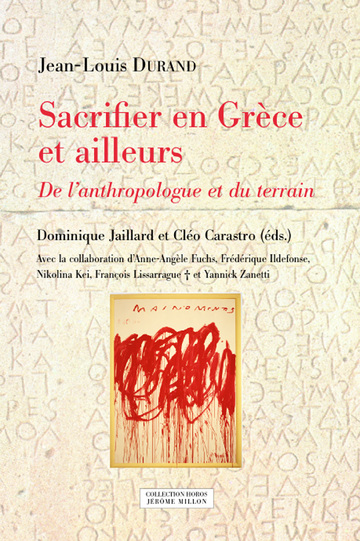Collections : Horos
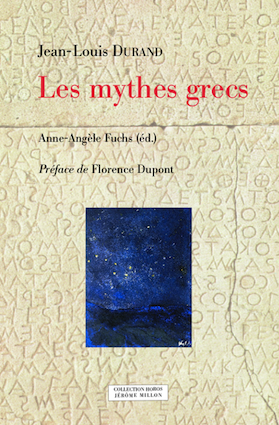
DURAND Jean-Louis
Les mythes grecs
ISBN : 2-84137-420-5
EAN13 : 9782841374205
Année : 2023
256 pages
26 €
Le mythe n’est pas un récit. Irréductible à un simple énoncé, il est de l’ordre de la pratique.
Les pratiques mythiques consistent en des types d’énonciation ancrés dans des espaces anthropologiques spécifiques. Elles produisent des fictions qui ont une fonction théorique, expérimentale : découvrir, entre les éléments de la réalité, les liaisons culturellement logiques. Il s’agit d’une exploration mythique de la culture.
Jean-Louis Durand reconstitue, à travers les empreintes mortes que sont les textes, des données de l’activité mythique à partir des conditions d’énonciation dans la culture vivante, dans la performance, dans le rite. Il convie le lecteur à un fascinant voyage, qui éclaire sous un jour nouveau les productions mythiques de la culture grecque, proposant des lectures radicalement neuves d'Homère, de la tragédie, des poèmes et des images de banquet. Ainsi, les escales d’Ulysse aux pays de Nulle-Part, fiction d’une sortie de l’humanité, font surgir, au miroir de la pratique humaine de l’hospitalité, liée, en Grèce, au rituel sacrificiel, autant de contrepoints à une société humainement possible, autant de réflexions sur ce qui construit une humanité possible.
• En attendant Nadeau : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2024/01/19/durand-mythes-grecs/
• Fabula : https://www.fabula.org/actualites/118434/jean-louis-durand-les-mythes-grecs.html
Le mythe n’est pas un récit. Irréductible à un simple énoncé, il est de l’ordre de la pratique.
Les pratiques mythiques consistent en des types d’énonciation ancrés dans des espaces anthropologiques spécifiques. Elles produisent des fictions qui ont une fonction théorique, expérimentale : découvrir, entre les éléments de la réalité, les liaisons culturellement logiques. Il s’agit d’une exploration mythique de la culture.
Jean-Louis Durand reconstitue, à travers les empreintes mortes que sont les textes, des données de l’activité mythique à partir des conditions d’énonciation dans la culture vivante, dans la performance, dans le rite. Il convie le lecteur à un fascinant voyage, qui éclaire sous un jour nouveau les productions mythiques de la culture grecque, proposant des lectures radicalement neuves d'Homère, de la tragédie, des poèmes et des images de banquet.
Les pratiques mythiques consistent en des types d’énonciation ancrés dans des espaces anthropologiques spécifiques. Elles produisent des fictions qui ont une fonction théorique, expérimentale : découvrir, entre les éléments de la réalité, les liaisons culturellement logiques. Il s’agit d’une exploration mythique de la culture.
Jean-Louis Durand reconstitue, à travers les empreintes mortes que sont les textes, des données de l’activité mythique à partir des conditions d’énonciation dans la culture vivante, dans la performance, dans le rite. Il convie le lecteur à un fascinant voyage, qui éclaire sous un jour nouveau les productions mythiques de la culture grecque, proposant des lectures radicalement neuves d'Homère, de la tragédie, des poèmes et des images de banquet.
Ainsi, les escales d’Ulysse aux pays de Nulle-Part, fiction d’une sortie de l’humanité, font surgir, au miroir de la pratique humaine de l’hospitalité, liée, en Grèce, au rituel sacrificiel, autant de contrepoints à une société humainement possible, autant de réflexions sur ce qui construit une humanité possible.
• En attendant Nadeau : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2024/01/19/durand-mythes-grecs/
• Fabula : https://www.fabula.org/actualites/118434/jean-louis-durand-les-mythes-grecs.html
Florence Dupont, PréfaceAnne-Angèle FUCHS et Dominique JAILLARD : Avant propos
0. INTRODUCTIONLire les mythes grecs aujourd’hui
0.1. L’invention de la mythologie 0.1.1. La fable 0.1.2. Le scandale des mythes 0.1.3. La mythologie hellénocentriste 0.2. Le mythe comme objet 0.2.1. Comprendre le mythe 0.2.2. La méthode structurale 0.2.3. Mythologie structurale et domaine grec 0.2.4. Le mythe introuvable ? 0.3. Le mythe comme pratique
I.MYTHE ET EPOS1.0.1. L’aède, la Mémoire et les Muses1.0.2. Chanter les dieux 1.0.2.1. Les dieux du polythéisme 1.0.2.2. Les dieux et la culture grecque 1.0.2.3. Mythes, rites et culture1.0.3. Mythe et sacrifice
1.1. Mythe et hymne1.1.1. Homère, Hymne à Athéna1.1.2. Homère, Hymne à Hermès
1.2. Mythe et théogonie1.2.0. Prélude1.2.1. Hésiode, Théogonie, les divinités primordiales1.2.2. Hésiode, Théogonie, les générations divines1.2.3. Hésiode, Théogonie, la naissance d’Athéna1.2.4. Les mythes théogoniques
1.3. Mythe et épopée1.3.1. Chanter les héros1.3.2. Hommes et dieux1.3.3. Une fiction mythique : l’Odyssée1.3.4. Les lieux de Nulle-Part 1.3.4.1. L’Odyssée : une escale violente : les Cyclopes 1.3.4.2. Construire les Cyclopes 1.3.4.3. L’anthropophagie 1.3.4.4. Les ruses d’Ulysse 1.3.4.4.1. La première ruse d’Ulysse 1.3.4.4.2. La seconde ruse d’Ulysse 1.3.4.5. La mémoire et le nom du héros1.3.5. L’entre-deux-mondes : la Phéacie 1.3.5.1. Les techniques des Phéaciens 1.3.5.2. La navigation des Phéaciens 1.3.5.3. L’accueil d’Ulysse 1.3.5.4. L’exploit d’Ulysse 1.3.5.5. La parole d’Ulysse 1.3.5.6. Le mythe de l’aède1.3.6. La terre des hommes 1.3.6.1. L’Odyssée : le mythe d’Ithaque
II.MYTHE ET POLIS2.0.1. La polis2.0.2. Le mythe dans la polis
2.1. Mythe et symposion2.1.1. Le banquet dans la cité2.1.2. Poésie et symposion : le chant, le vin, l’amour2.1.3. Poésie lyrique et épopée2.1.4. L’image mythique au symposion 2.1.4.1. Mythe et image 2.1.4.2. Les mythes du divin 2.1.4.3. Un héros sympotique : le satyre2.1.5. Dionysos ou l’indistinction2.1.6. Rite, mythe, image2.1.7. Le regard de Dionysos
2.2. Mythe et agôn2.2.1. Les concours agonistique 2.2.2. La gloire du vainqueur2.2.3. Le vainqueur et le héros2.2.4. Énonciation mythique et ode triomphale2.2.5. Le mythe pindarique 2.2.5.1. Le cadre rituel de l’énonciation 2.2.5.2. Les mythes d’Héraklès 2.2.5.3. La gloire de Théron
2.3. Mythe et rituel tragique2.3.1. Les mythes tragiques2.3.2. Le rituel tragique2.3.3. Les agents du rituel tragique 2.3.3.1. Les personnages et le chœur 2.3.3.2. Le poète 2.3.3.3. Le public2.3.4. La fiction tragique 2.3.4.1. Sophocle, Electre et Antigone : des mythes du deuil 2.3.4.2. Euripide : Hippoyte ou l’éphèbe immobile 2.3.4.2.1. Le jeune homme et la cité d’Athènes 2.3.4.2.2. Le chasseur abstinent 2.3.4.2.3. Au-delà de la forêt 2.3.4.2.4. Le délire d’amour 2.3.4.2.5. La mort d’Hippolyte 2.3.4.2.6. Un héros du passage 2.3.4.3. Les Bacchantes d’Euripide : un mythe tragique du masque 2.3.4.3.1. Le cas Penthée 2.3.4.3.2. Les femmes de Dionysos 2.3.4.3.3. Dionysos au vin 2.3.4.3.4. Dionysos masque 2.3.4.3.5. Les fausses Bacchantes 2.3.4.3.6. Mourir par Dionysos 2.3.4.3.7. Dionysos dans la cité
2.4. Mythologie et mythographie2.4.1. Chasser le lion2.4.2. Combattre à mains nues2.4.3. La peau et les griffes2.4.4. Mythologie et pensée mythique
2.5. Un exemple de lectures comparées : Hésiode et Platon2.5.1. Le mythe de Prométhée 2.5.1.1. Platon, Protagoras 2.5.1.2. Hésiode, Théogonie2.5.2. Pensée et exploration mythiques
Annexe. Tableau synoptiqueSources anciennes. Liste des éditions utiliséesListe des figuresSommaire
0.1. L’invention de la mythologie