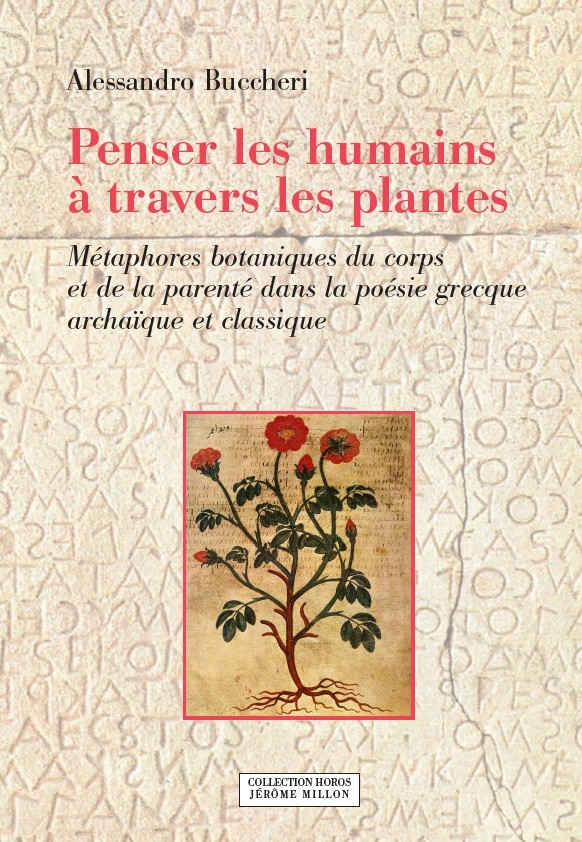
BUCCHERI Alessandro
Penser les humains à travers les plantes
Métaphores botaniques du corps et de la parenté dans la poésie grecque archaïque et classique
Préface par Maurizio Bettini
ISBN : 2-84137-434-2
EAN13 : 9782841374342
Année : 2024
416 pages
34 €
Depuis l'Antiquité, les textes poétiques ont souvent eu recours à des métaphores et des comparaisons décrivant la vie humaine à travers le monde des plantes. Certaines de ces images sont si fréquentes que le lecteur contemporain tend à les considérer comme de simples clichés poétiques. À travers la poésie latine, puis médiévale, elles sont entrées dans le langage poétique commun des littératures européennes.
Centré sur les textes poétiques composés en Grèce entre le VIIIe et le Ve siècle avant notre ère, ce travail convoque tour à tour les écrits médicaux et philosophiques, les représentations religieuses et les mythes de métamorphose, afin d’inscrire les métaphores botaniques étudiées dans des réseaux conceptuels faisant partie du savoir partagé.
Préface par Maurizio Bettini Avant-Propos Abréviations, textes et traductions
INTRODUCTION 1. « Apprendre des arbres et des plantes » : une promenade aux bords de l’Ilissos. 2. Les métaphores botaniques grecques : un objet trop familier ? 3. Par-delà la figure de style : penser par métaphores. 4. La théorie cognitive de la métaphore et l’étude de la poésie grecque. 5. Métaphores, « affordances » et l’approche émique des cultures anciennes. 6. Pour une approche anthropologique des métaphores botaniques dans la poésie archaïque et classique.
CHAPITRE I. « Se promener au milieu d’une végétation étrangère » : le paysage des métaphores botaniques grecques. 1. Le lexique botanique grec et ses particularités. 2. Les parties pérennes de la plante. 3. Les parties annuelles de la plante, sa croissance, son épanouissement. 4. Production et reproduction de la plante. 5. La mort de la plante. 6. Pistes de travail.
CHAPITRE II. « Près de la marée clandestine de l’arbre » : la sève des plantes et les humeurs du corps. 1. Qu’est-ce qu’une fleur ? la sève des plantes. 2. La construction d’une scène homérique : Simoïsios « florissant » et le peuplier noir. 3. Fleurir, affleurer : les larmes des héros homériques et de leurs femmes. 4. « La fleur de ta jeunesse bouillonne » : la sève, le corps et les âges de la vie. 5. Croissance végétale et développement du f?tus dans le traité hippocratique De la génération/De la nature de l’enfant.
CHAPITRE III. « La force qu’à travers la tige verte… » : plantes, apparence et émotions. 1. Préambule : le corps coloré. 2. « Plus verte que l’herbe » : la manifestation des émotions dans le fr. 31 V. de Sappho. 3. « Changer la fleur de sa peau » : une esthétique végétale de l’apparence physique. 4. Une lumière « d’hyacinthe et d’or » : images de la charis dans la poésie archaïque. 5. L’éclosion du désir et de la maladie : une physiologie poétique des émotions. 6. Des plantes trop luxuriantes : métaphores de l’hubris d’Hésiode à Bacchylide. 7. Plantes « hubristiques » et « efféminées » : les affections des végétaux chez Théophraste.
CHAPITRE IV. De la métaphore au récit : la métamorphose des Héliades. 1. De la métaphore à la narration : repères théoriques. 2. Une histoire que chacun connait : le récit de métamorphose des Héliades dans les textes grecs. 3. L’ambre et les larmes des plantes : savoirs naturalistes et récits de métamorphose. 4. La métaphore et l’univers fictionnel du récit : les filles du Soleil et les confins du monde. 5. Décrire la métamorphose : une excursion dans la poésie latine.
CHAPITRE V. Les métaphores du corps, de l’innéité et de la généalogie. 1. Le développement arborescent du corps dans les poèmes homériques. 2. La scille, la rose et l’hyacinthe : espèces botaniques et questions généalogiques dans les Theognidea. 3. Les vertus innées des Emménides de la racine à la fleur : Pindare, Olympique 2. 4. Métaphores végétales et continuité généalogique en tragédie : Philoctète de Sophocle. 5. Variations sur un thème : autres métaphores botaniques de la parenté. 6. La partie et le tout : parents et enfants, plantes et bourgeons chez Aristote et Théophraste.
CHAPITRE VI. Le lignage et la terre : métaphores de l’identité citoyenne et de la reproduction. 1. Les plantes et la double identité des Danaïdes : les Suppliantes d’Eschyle. 2. Métaphores végétales et récits d’autochtonie sur la scène tragique. 3. Le cas d’Oreste : variations sur la mère et la terre. 4. Le fœtus et la mère dans le traité De la génération/De la nature de l’enfant.
CONCLUSION
bibliographieindex locorum index rerum
Préface par Maurizio Bettini