Collections : HISTOIRE Mémoires du Corps
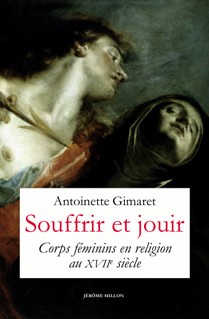
GIMARET Antoinette
Souffrir et jouir
Corps féminins en religion au xviie siècle
ISBN : 2-84137-445-8
EAN13 : 9782841374458
Année : 2025
328 pages
27 €
«En un instant il s’avança & il me blessa d’une fleche ardente, qui me fit une profonde blesseure au fond de mon cœur, & avec une douleur si vive & si inexperimentée, que je tremoussois toute, & si j’eusse êté seule je n’eusse pu m’empêcher de crier & de m’élancer contre terre, ne pouvant plus me soûtenir. La seule modestie & la crainte que l’on ne s’aperçeut de la visite de Dieu en moy, me retint, & résistant ainsi à ce qui m’emportoit hors de soy-méme, je continüay mon petit exercice, souffrant & soutenant le mieux que je pouvois la vehemence de la douleur ; mais douleur si douloureuse, qu’il me vint quelque crainte d’en être guerie pour la suavité qu’elle m’apportoit. »
Des "visites de Dieu en elles", "des suaves douleurs", "des fleurs de consolations divines"… les femmes mystiques jouissent de leur corps.
Si l’alliance des deux termes Souffrir et jouir semble relever de l’attendu ou du cliché, celui qui associe de manière récurrente le corps féminin à la passivité absolue de la souffrance et de l’extase, il permet aussi de faire signe vers une tension oxymorique sans cesse à l’œuvre, dans ces récits du corps, entre douleur et jouissance, horreur et délice, dégoût et suavité, destruction et restauration des chairs, alliance des contraires qui participe d’un merveilleux corporel omniprésent. Jacques Le Brun, dans sa réflexion sur le pur amour, a souligné qu’au xviie siècle le terme, pourtant issu de gaudere (se réjouir), prend davantage le sens latin de frui, tirer avantage, jouir des fruits, avoir à disposition quelque chose. De ce fait, dans la mystique jouir de Dieu c’est avoir Dieu à disposition et « jouir de soi en Dieu », l’acte de jouissance supposant non pas la passivité absolue mais l’exercice de la volonté et du jugement : le sujet décide de ce qui sera l’objet de sa jouissance. Le « jouir » renvoie donc aussi, chez ces femmes mystiques, à la part moins connue de l’agir. Qu’elles soient extatiques, contemplatives ou grabataires, les récits les montrent jouissant de leur corps, au sens où elles en disposent, jouissent de ses facultés, épuisent ses forces et, « femmes fortes », agissent travaillent, guérissent, bâtissent et créent. Même leur part souffrante ne peut se réduire à la Passio et à l’Imitatio : elle est aussi un exercice constant de la volonté et va de pair avec l’invention de soi. Car la sainteté féminine n’est pas un état d’abandonnement : par le corps, elle s’expérimente, elle s’exhibe, elle agit et transforme.
Introduction : l’hagiographie et les récits du corps féminin à l’âge moderneSources et principes pour l’édition des textes
Partie I/ Corpus Dolens
Chapitre I : Être malade Tableaux cliniques
Le martyre chirurgical
Un corps charogne
Chapitre II : les noces de la Croix - Participer à la Passion
- L’Époux et l’Épouse
- Pénétrations mystiques
Chapitre III : Se faire mal - Mortification du corps et Imitation du Christ
- Vaincre la nature, domestiquer la bête, surmonter le dégoût
- Virtuosités doloristes
Partie II/ La chair des merveilles
Chapitre I : Un parfum de scandale- Être une proie : sainteté et violence de genre
- Fréquenter le diable
- Au risque de l’indécence : extases et transfigurations
Chapitre II : Miracles vivants- Les stigmates et leurs variantes
- Échapper aux lois de nature
- Guérisons miraculeuses
Chapitre III : Sublimations : du cadavre à la relique- Cadavres exquis
- Saintes exhumations
- Le corps en morceaux : les reliques et leurs vertus
Partie III/ les vertus de l’agir
Chapitre I : Travailler son apparence Chapitre II : « l’industrie » charitable Chapitre III : corps au travail, corps efficace
Liste complète des sources Liste des figures féminines évoquées Bibliographie critique sélective
Le martyre chirurgical
Un corps charogne
Chapitre II : les noces de la Croix
- Participer à la Passion
- L’Époux et l’Épouse
- Pénétrations mystiques
Chapitre III : Se faire mal
- Mortification du corps et Imitation du Christ
- Vaincre la nature, domestiquer la bête, surmonter le dégoût
- Virtuosités doloristes
- Être une proie : sainteté et violence de genre
- Fréquenter le diable
- Au risque de l’indécence : extases et transfigurations
- Les stigmates et leurs variantes
- Échapper aux lois de nature
- Guérisons miraculeuses
- Cadavres exquis
- Saintes exhumations
- Le corps en morceaux : les reliques et leurs vertus