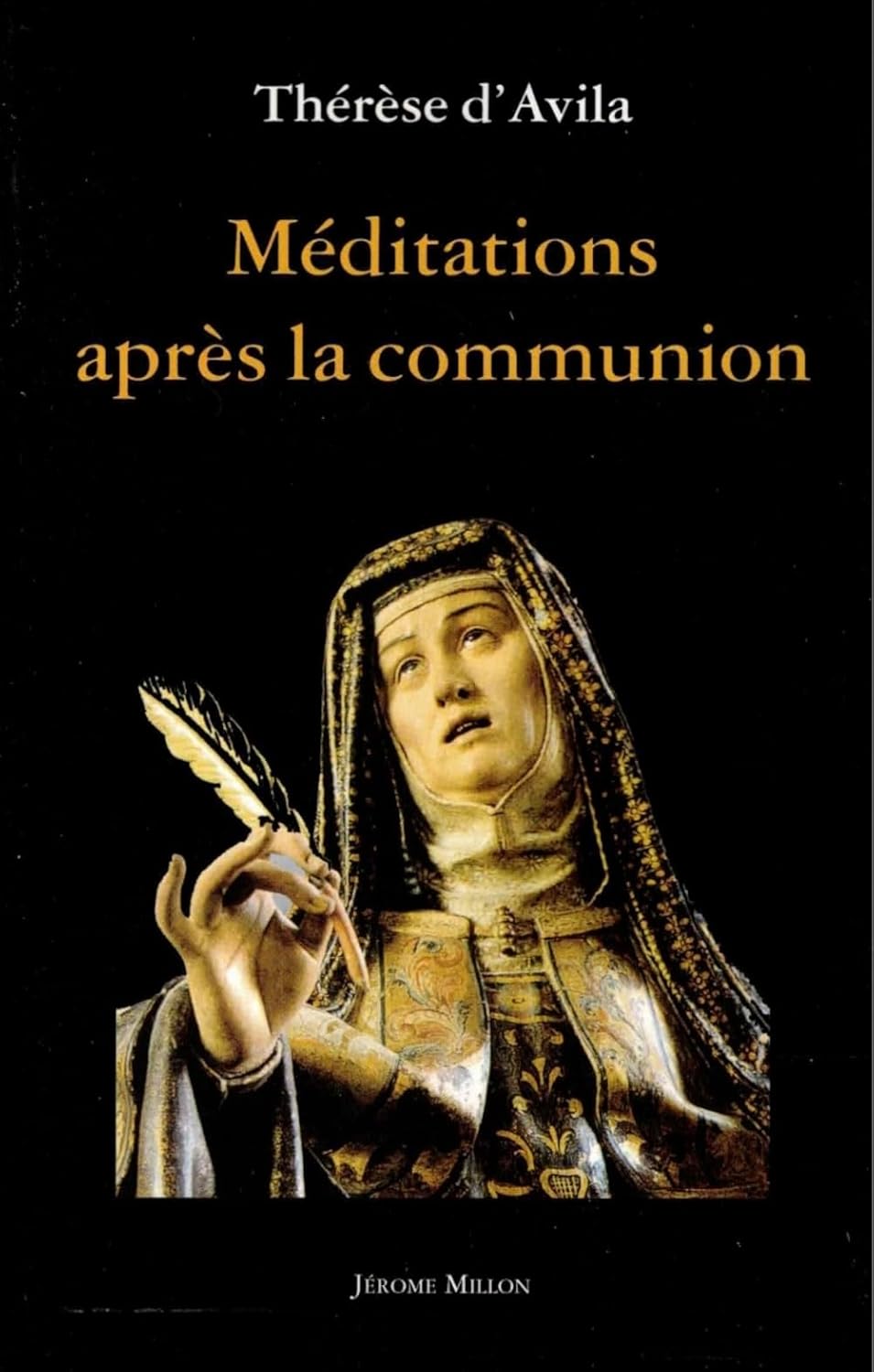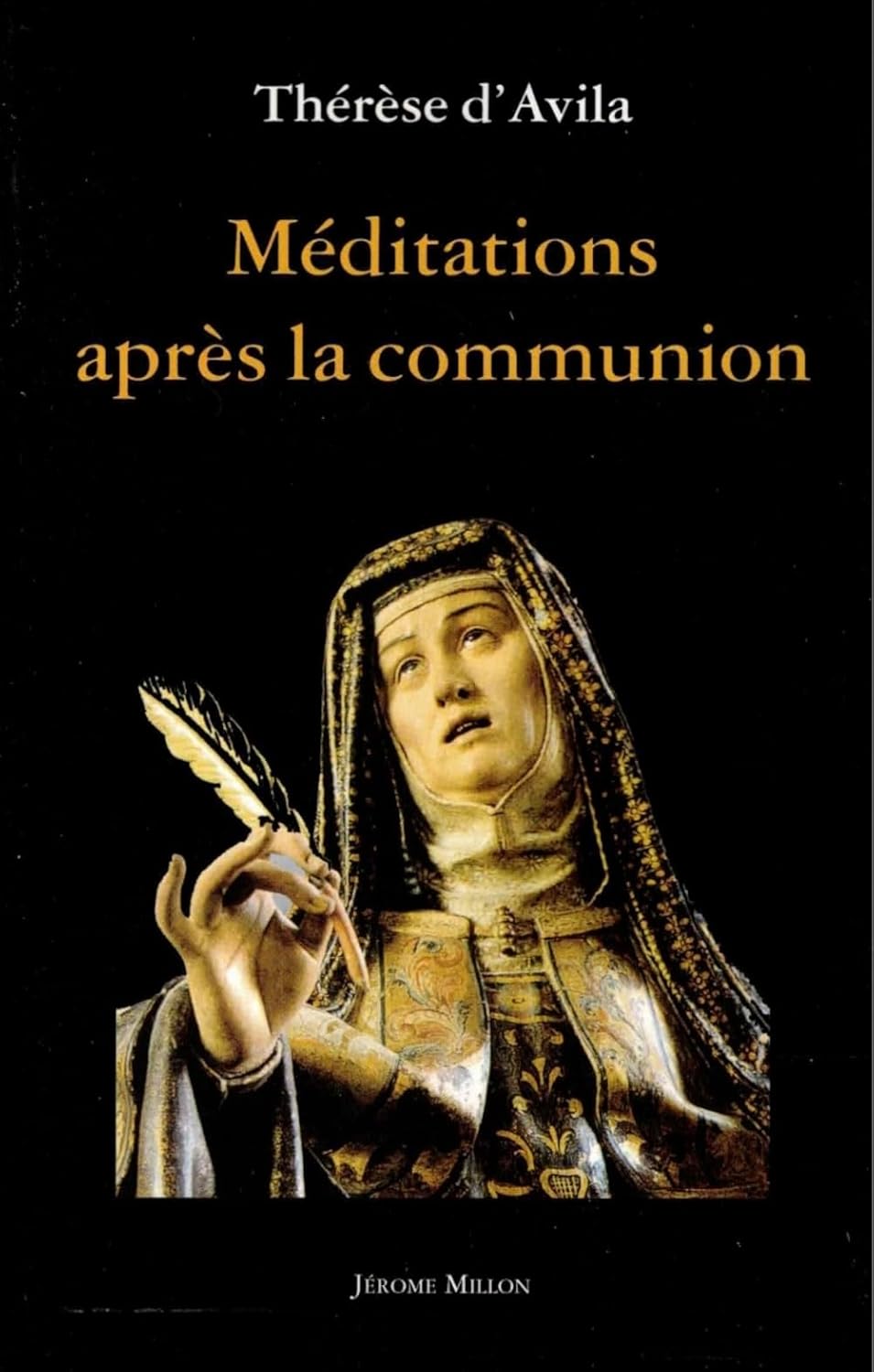« Ô ma vie, ma vie, comment pouvez-vous subsister étant absente de votre
véritable vie ?… » Dans leur inarticulation déroutante et fragmentaire,
Luis de León, osa pour la première fois en Espagne publier les
Exclamations de Thérèse d’Avila en 1588. Ces pages, dans lesquelles la
religieuse, en proie à la souffrance de l’absence et de la déréliction,
appelle Dieu, son âme, les mots qui s’échappent et refusent tout
apaisement, furent écrites vers 1566. Une dizaine d’années plus tard,
dans son commentaire au Cantique des Cantiques, texte dont la lecture en
castillan avait été interdite par l’Inquisition, la mystique cesse
d’être femme délaissée qui implore pour redevenir écrivain. Écrivain,
c’est-à-dire lectrice du texte biblique, confrontée au mystère de
l’amour et à l’inconnu d’une traduction latine – « chaque fois que
j’entends ou que je lis certaines paroles du Cantique de Salomon, et
sans que pour autant je sois capable de traduire la clarté du latin en
castillan, je me recueille plus et mon âme s’émeut davantage que lorsque
je lis les livres très pieux que je comprends ». Arnauld d’Andilly
entreprend à son tour une traduction de ces deux textes qui paraissent à
Anvers, en 1607, dans le cadre d’une version française des Œuvres
complètes de Thérèse, sous le nom de Méditations après la Communion et
Pensées sur l’amour de Dieu.
La lecture parallèle du texte espagnol
et de la traduction française permet de mesurer l’écart de sensibilité
entre la mystique engagée dans sa propre expérience, et l’interprète qui
introduit, dans la trame de la pensée féminine, la mesure et la
rationalité de sa langue classique.