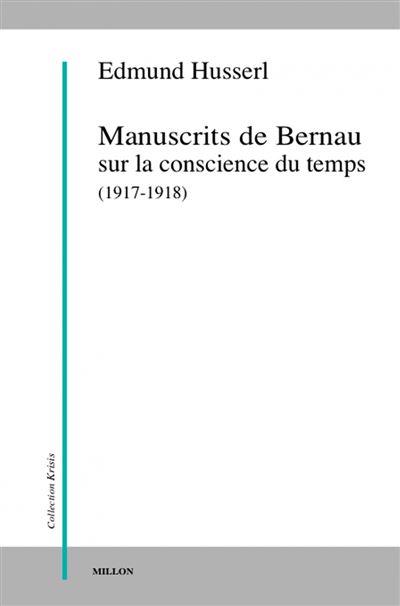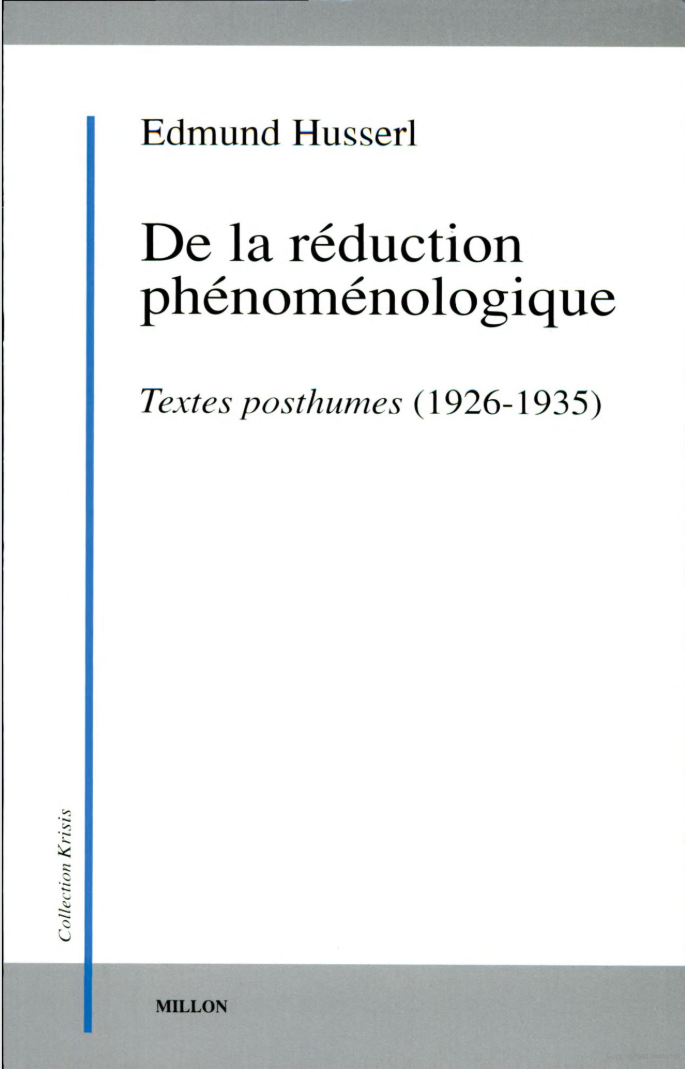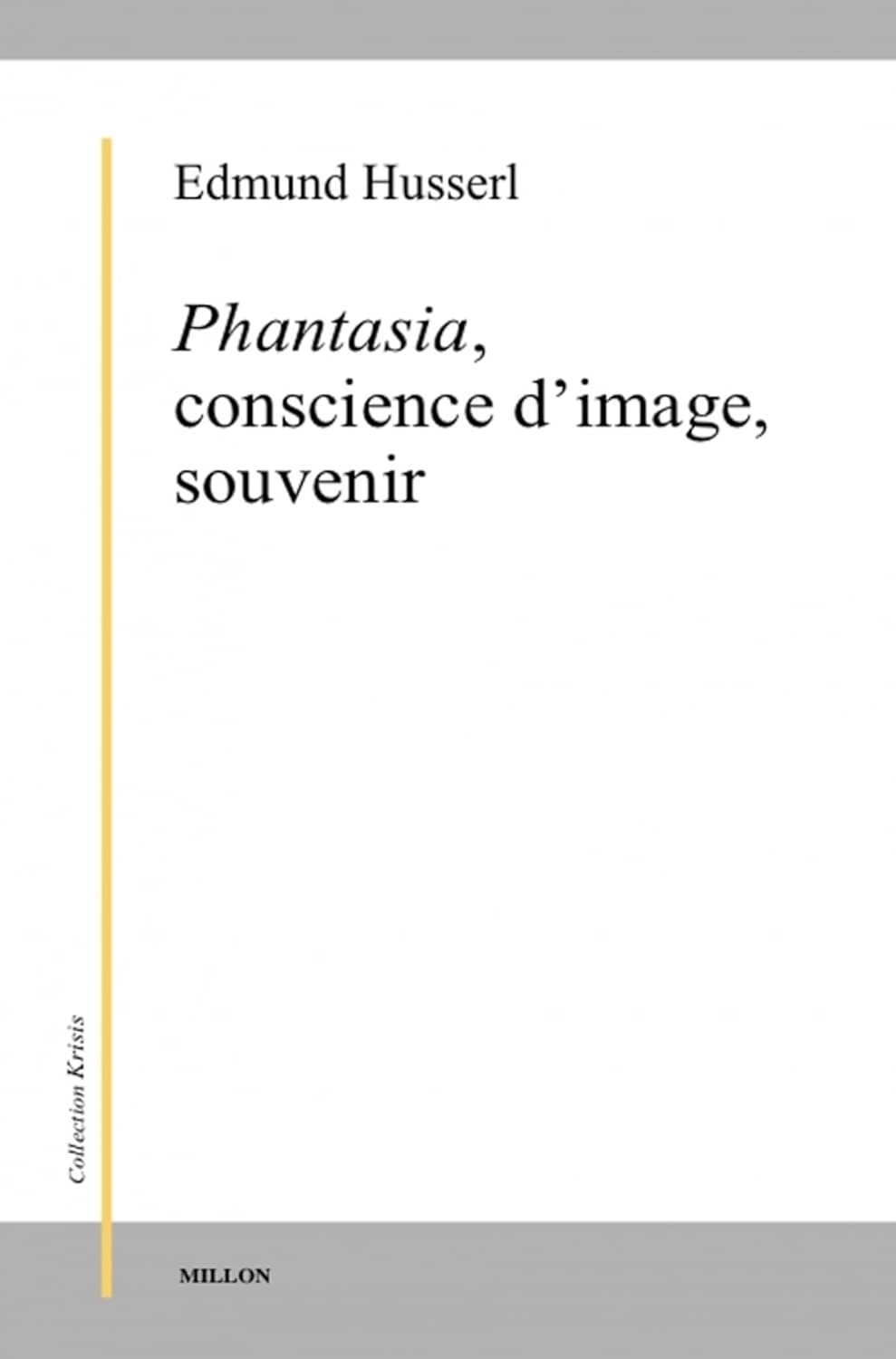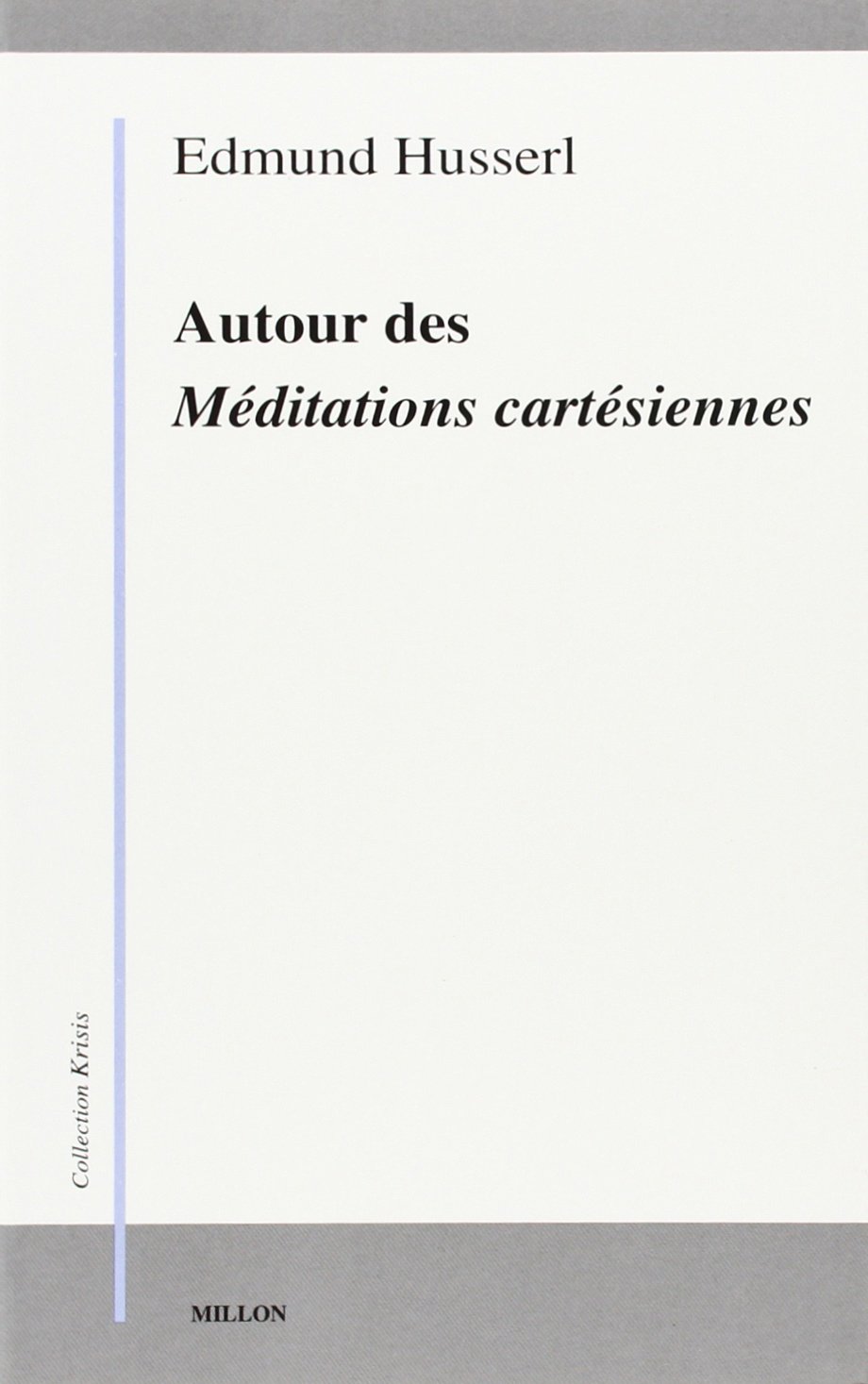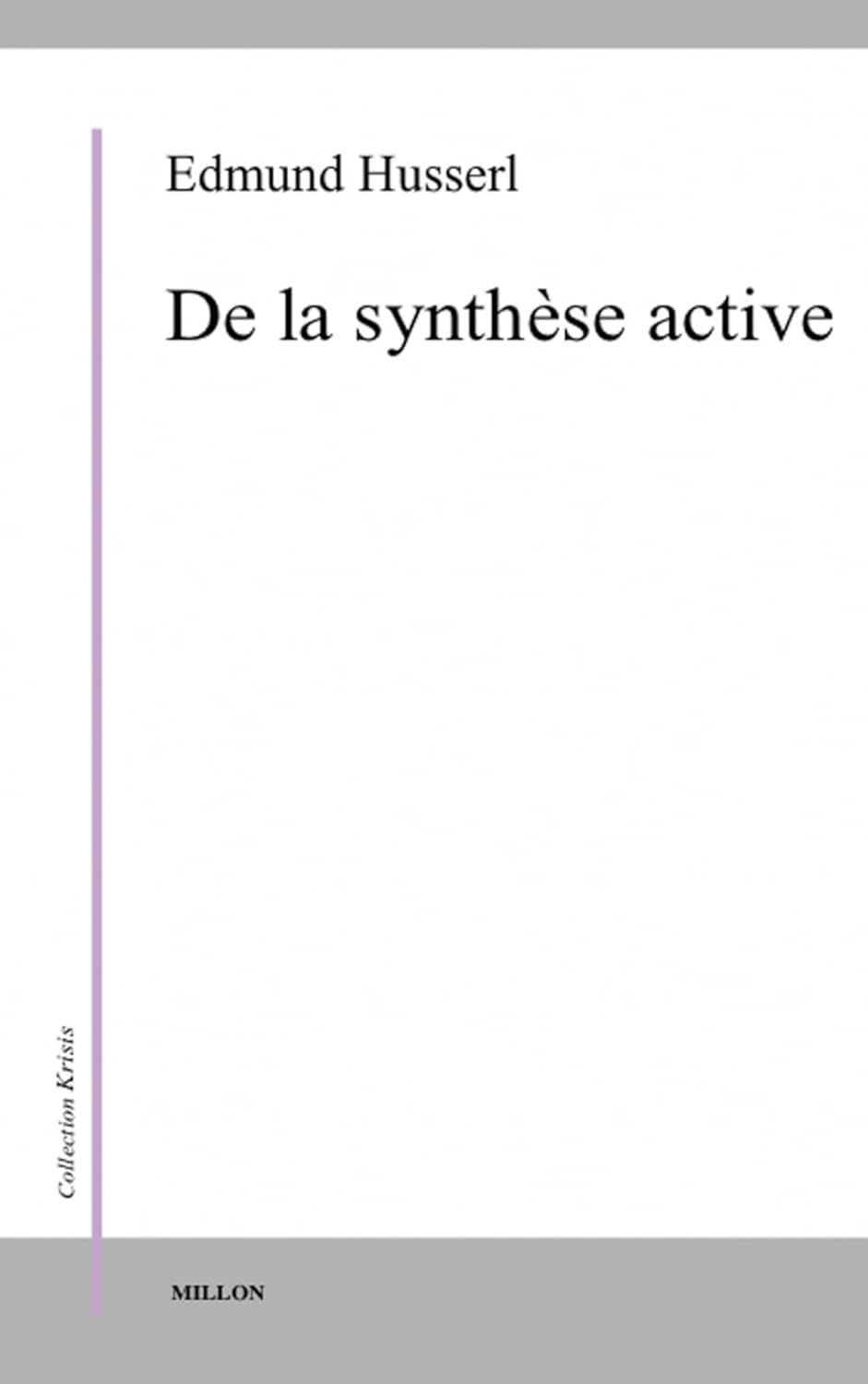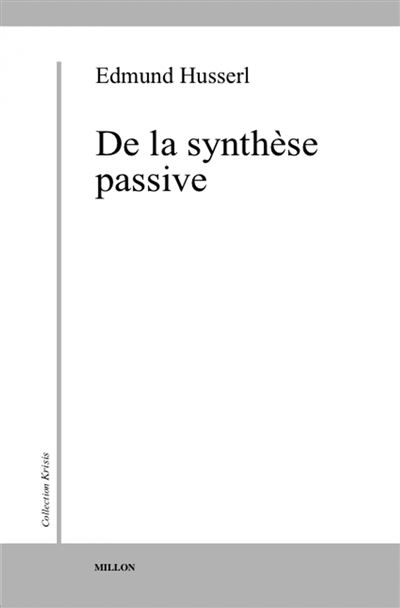Collections : PHILOSOPHIE Krisis
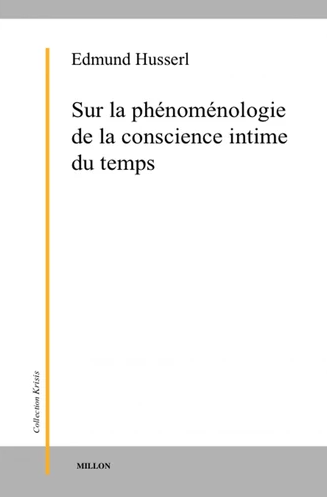
HUSSERL Edmund
Sur la phénoménologie de la conscience intime du temps
ISBN : 2-84137-148-4
EAN13 : 9782841371484
Année : 2003
304 pages
31.45 €
Si la partie « A » du volume x des Husserliana, c’est-à-dire les désormais classiques Leçons sur la conscience intime du temps
élaborées par Edith Stein et publiées par Martin Heidegger en 1928, est
depuis longtemps à la disposition du lecteur d’expression française, la
place exceptionnelle qu’occupe la question du temps dans la philosophie
en général, et dans la phénoménologie de Husserl en particulier,
justifie qu’on livre enfin au public la partie « B » qui regroupe des
textes de la période 1893-1917 pour la plus large part écartés par la
compilation trop systématiquement recomposée d’E. Stein.
Les perspectives qu’ouvre ce volume, formant une unité
indépendante en soi, non seulement ne peuvent pas s’acquérir à partir du
corpus Stein/Heidegger, mais surtout permettent de mieux comprendre la
complexité et l’évolution d’une recherche inlassable seulement condensée
dans les Leçons, et de cerner les apories qui sont « au travail »
de façon incessante dans les textes ici traduits et qui tiennent, en
leur racine commune, à la conception unidimensionnelle de la temporalité
à laquelle Husserl n’a jamais voulu renoncer.
C’est la phénoménologie de la perception qui, encore une fois,
fournit le cadre initial des analyses : l’intentionnalité s’y institue
selon un mode de temporalisation qui est celui du présent vivant en flux
continu, muni de ses rétentions et de ses protentions. Cette affinité
élective entre intentionnalité et temps conduit même à dégager une
double intentionnalité, dont on peut se demander en quel sens elle est
encore intentionnalité, et qui est très vite vouée à déborder cette
effectuation conscientielle spécifique qu’est la perception pour
s’affronter aux redoutables problèmes de l’intropathie et de la phantasia.
La part est ainsi faite à la fois aux analyses concrètes — satisfaisant par là à l’exigence d’attestabilité
de la phénoménologie —, aux analyses formelles — souvent par
abstraction géométrisante des premières —, mais aussi au dialogue
d’ordre historique avec les conceptions contemporaines que défendaient
alors Brentano, Meinong ou Stern.
Le texte est précédé d’une riche introduction restituant les présentations des deux éditions allemandes existantes.

_______________________
SOMMAIRE
Avant-propos du traducteur
Introduction de Rudolf Bœhm
Introduction de Rudolf Bernet
Comment en vient-on à la représentation de l’unité d’un déroulement de changement continué plus longuement ?
Evidence de la perception temporelle, du souvenir, etc.
Méditation.
Intuition. Evidence de l’être-passé – simple représentation de l’être-passé. Adéquation par similitude – Représentation d’un objet et représentation de la perception d’un objet.
Disputation.
Ancienne et première observation de ce qu’il existe une différence d’essence entre la conscience-de-passé originelle et le ressouvenir.
Les phases instantanées de la perception ont-elles le caractère d’imaginations au regard des parties écoulées de l’objet temporel ?
Perception d’un temporel et perception de la temporalité
Si la modification intuitive, grâce à quoi il y a souvenir immédiat à partir de la perception, peut s’entendre comme un simple changement du contenu présentant. (Brentano ne peut ici servir que d’exemple).
Temps et souvenir.
Le caractère du souvenir. – Représentation par identité : que faut-il entendre par là ?
<1904 et début 1905>
< N°22> Un souvenir adéquat est-il (ou comment est-il) possible ?
L’unité du temps et son infinité
Perception d’un objet individuel (temporel).
Souvenir adéquat. Perception antérieure. – Perception du passé. Tentative (aporie).
Hypothèse d’après quoi les perceptions incluraient une « déterminité temporelle » comme maintenant de chaque fois, mais qui se changerait constamment, et selon laquelle le souvenir primaire aurait la signification du perdurer de cetteperception.
L’identité du son, de l’objet temporel et de chaque phase de l’objet temporel dans le flux de la conscience temporelle
La distinction de Meinong entre objets distribués et non distribués
Croquis.
Continua
Résultats de la discussion Stern-Meinong
Manuscrits de Seefeld sur l’individuation. 1905 1907>
Unité de la chose temporelle comme un identique du changement ou du non changement
réflexion de Seefeld.
L’objet temporel
Objection contre tout ce genre de considérations de Seefeld
<1907 à 1909>
Temps dans la perception
Niveaux de l’objectivité
Apparition et temps. – Vivre et vécu. La conscience comme le vivre dans lequel les vécus-de-conscience sont vécus au pluriel
Evidence
Problème
La forme temporelle de la conscience
Repoussement temporel originel
?
La modification-de-souvenir primaire
1909 jusqu’à fin 1911
Simples représentations de processus ou d’objets individuels (qui durent). Évidence de la perception mémorielle, évidence de la perception de présent
L’intentionnalité de la conscience interne
Lexique allemand/français
Lexique français/allemand