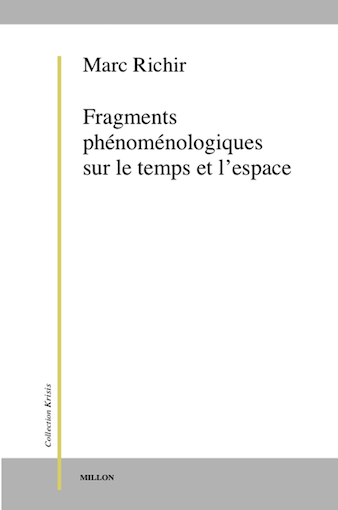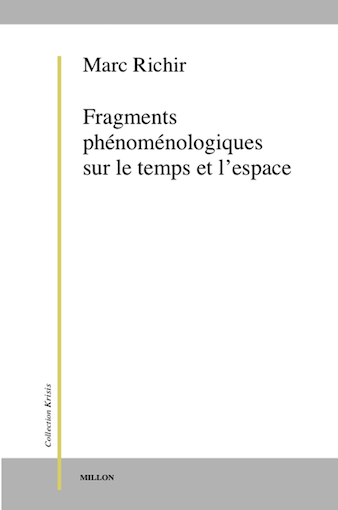Toucher aux problèmes et questions posés par le temps et l’espace, c’est
toucher à ce qui paraît toujours aller le plus de soi dans notre
expérience la plus courante, est le moins souvent interrogé et le plus
souvent présupposé. Même si la tradition philosophique en a tenté plus
d’une fois l’expérience, et ne nous laisse pas tout à fait démunis, elle
y a été confrontée à maintes difficultés, devenues classiques, et qui
comportent en elles-mêmes, dans le traitement qu’elle en propose, des «
évidences » qu’il paraît absurde de soumettre au doute. Par exemple,
l’écoulement du présent ou la distinction dedans / dehors.
La dernière élaboration systématique, et classique dans son esprit, de
ces problèmes et questions, est celle de Husserl, manifestement en écho
à celles d’Aristote et d’Augustin. Or, pour peu qu’on l’examine depuis
la refonte de la phénoménologie proposée dans le présent ouvrage, elle
révèle tout à la fois ses limites et ses présupposés, et conduit
inexorablement à des paradoxes (dont ceux de Zénon) – ceux-là même que
la tradition avait déjà rencontrés pour les éviter, pour s’assurer d’une
stabilité au moins relative.
Tirer les fils qui conduisent à ces paradoxes, en découvrir
l’organisation interne – l’architectonique –, c’est donc mettre à jour
quelques-unes des racines les plus profondes de la tradition ainsi que
leurs motifs phénoménologiques cachés. C’est donc aussi s’exposer à
l’inconfort d’un voyage sur un continent sans repères fixes, dont on n’a
pas la carte, et en être réduit à l’exploration par fragments, de
proche en proche, par zigzags, avec la présomption que toute carte ne
peut être qu’une représentation construite et théorique. Il faut se
résoudre à ce que la phénoménologie refondue au-delà de l’ordre des
eidétiques soit une sorte très paradoxale de mathesis de l’instabilité.